
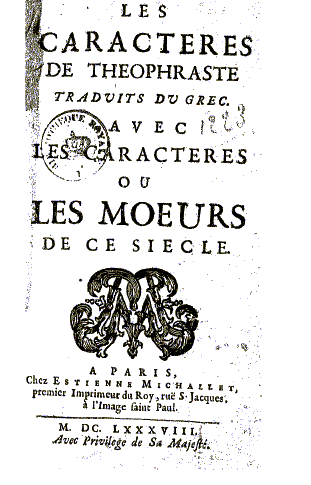

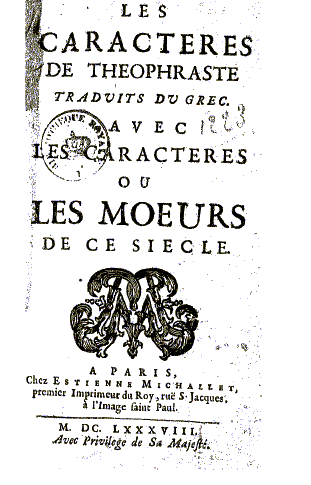
Nous utiliserons l'édition « classiques de
Poche », avec introduction et notes d'Emmanuel Bury, Livre de Poche n°
1478.
|
|
L'œuvre et l'auteur : |
Les sources : · Autres sources antiques (Lucrèce, Cicéron, Sénèque, Tertullien… |
L'art du Moraliste au XVIIème siècle · La comédie (Molière) · La fable (La Fontaine) · Les Maximes (La Rochefoucauld) · La philosophie (Pascal, Descartes) |
|
La satire |
|||
|
· Le « theatrum mundi · Rivalité avec Molière |
La Bruyère est le moins connu des auteurs de son temps ; il ne s'est pas mêlé, comme La Fontaine, Boileau ou Saint-Évremond à l'actualité de son époque, n'a participé à aucun salon, et il est l'homme d'un seul livre – si l'on adjoint aux Caractères les annexes, Discours sur Théophraste, et Discours à l'Académie française.
Jean de La Bruyère est né à Paris en août 1645 ; son père est un roturier, contrôleur général des rentes de l'Hôtel de Ville (même si La Bruyère affirme avec humour descendre des Croisades) ; à la mort de celui-ci, l'enfant est élevé par son oncle.
Licencié en droit, il abandonne le barreau en 1673 ; il achète une charge dans la Généralité de Caen, mais n'y alla jamais, et abandonna l'office en 1686. Il entre alors au service des Condé, comme sous-précepteur du duc de Bourbon, petit-fils du Grand Condé. Après le mariage du jeune homme, alors âgé de 16 ans, avec une fille légitimée de Louis XIV et Mme de Montespan, en juillet 1685, il devient aussi précepteur de la jeune femme. Il abandonne cette charge après la mort du Grand Condé (11 décembre 1686), mais reste dans la maison comme « gentilhomme ordinaire » et pensionné du Duc.
En 1688 paraît la première édition des Caractères (voir ci-dessous).
Il participe à la violente querelle des Anciens et des Modernes, en prenant parti pour les premiers ; ce qui lui vaut d'échouer à l'Académie française contre Fontenelle, en 1691. Finalement élu en 1693, il prononce son Discours à l'Académie, qui donne une idée de la virulence des débats.
Il avait commencé des Dialogues sur le quiétisme, dans lesquels il prenait parti pour Bossuet contre Fénelon, mais il mourut d'apoplexie, le 11 mai 1696. Les Dialogues parurent après sa mort, en 1698.
La Bruyère est, plus encore que Montaigne, l'homme d'un seul livre. Il l'a publié une première fois alors qu'il était déjà âgé de 42 ans, et il l'a enrichi durant les six années suivantes. Entre la 1ère édition (1688), qui ne comptait que 420 remarques, et ne se présentaient que comme un appendice à une édition des Caractères de Théophraste, et la dernière, de 1696, qui en contient 1120, l'ouvrage a grossi constamment, et est devenu de plus en plus indépendant et personnel, comme le montre le tableau que l'on trouve dans Van Delft 1971, p. 17 (voir bibliographie), qui fait état des additions des différentes éditions :
|
Chapitres |
I-III (1688) |
Ed. IV (1689) |
Ed. V (1690) |
Ed. VI (1691) |
Ed VII (1692) |
Ed. VIII-IX (1694-1696) |
TOTAL |
|
I - Des ouvrages de l'esprit II - Du Mérite personnel III - Des Femmes IV - Du Cœur V -De la Société et de la Conversation VI -Des Biens de Fortune VII - De la ville VIII - De la Cour IX - Des Grands X - Du Souverain ou de la République XI - De l'Homme XII - Des Jugements XIII -De la Mode XIV -De quelques usages XV - De la Chaire XVI - Des Esprits forts Épilogue |
35 23 37 18 35 29 4 39 19 11 72 30 10 18 15 24 1 |
16 8 18 49 23 17 9 24 18 9 49 55 7 28 7 7 0 |
10 6 10 12 19 22 6 13 7 3 17 14 1 12 2 5 0 |
3 2 1 2 0 7 0 11 11 1 7 7 11 10 1 0 0 |
3 3 16 5 3 4 0 9 2 9 6 4 0 1 3 9 0 |
2 2 0 -1 3 4 3 5 -1 2 7 9 2 4 2 4 0 |
69 44 82 85 83 83 22 101 56 35 158 119 31 73 30 49 1 |
|
TOTAL |
420 |
344 |
159 |
74 |
76 |
47 |
1120 |
Beaucoup de maximes et peu de développements, excepté le portrait de Louis XIV (X, 35) ; peu d'allusions à l'actualité, une morale souvent peu approfondie, et un pessimisme encore assez peu marqué. Les attaques sont générales, (sauf contre le Mercure Galant), et La Bruyère semble plus préoccupé de style que de morale. Enfin, l'ouvrage semble une simple amplification des Caractères de Théophraste, qui occupent (avec le discours qu'il leur consacre) 149 pages sur les 210 de l'ouvrage. Deux autres éditions, la même année, n'apporteront que fort peu de changements.
La Bruyère est un auteur qui écrit lentement : il lui a fallu dix ans pour écrire les 420 premières remarques… Or, entre la 3ème et la 4ème édition, il ne s'écoule que 10 mois… et elle a presque doublé ! Il faut donc supposer que La Bruyère avait déjà écrit les 764 remarques de la 4ème édition, et probablement davantage, et qu'il n'a publié en 1688 qu'un « ballon d'essai »…
Pour la première fois apparaît l'épigraphe d'Érasme, « j'ai voulu avertir, et non mordre », tandis que la Préface, remaniée, prend un sens nettement moral. Dans cette édition, les portraits, presque inexistants dans la première, deviennent plus nombreux – une cinquantaine ; cependant la maxime demeure prédominante, en particulier dans le chapitre Du Cœur, où La Bruyère s'inspire le plus de La Rochefoucauld. Cependant la peinture devient plus détaillée, plus expressive, plus concrète. Les sujets abordés sont plus variés, et l'auteur, plus sûr de lui, fait preuve de verve (pastiches du « vieux langage », p. ex.). Et la condamnation se fait plus ferme, plus virulente… et le pessimisme plus noir.
159 remarques supplémentaires, en 13 mois… mais ici le ton a changé, est devenu plus amer, plus violent, la mort devient très présente. Peut-être est-ce lié au contexte – l'année 1689, marquée par la révolution anglaise, a été triste – mais ici, La Bruyère montre son visage mélancolique et sombre. Pour la première fois il aborde le thème de la famille, où ne règne nulle affection véritable, où l'argent corrompt tous les sentiments. Le monde est le lieu de l'illusion ; la société, loin d'améliorer l'homme, n'est qu'un garde-fou factice et trompeur. La Bruyère met beaucoup de lui-même, de ses idéaux déçus, dans son livre.
Pour la première fois, les Caractères de Théophraste sont imprimés en caractères plus petits que ceux de La Bruyère ; ceux-ci connaissant 74 ajouts, essentiellement concentrés sur 7 chapitres. Pour la première fois, il retire un texte, Sur les Courtisans disgraciés (X, 19), peut-être pour ne pas froisser Bussy-Rabutin, condamné à l'exil pour avoir publié l'Histoire amoureuse des Gaules (1665)
Les portraits deviennent nombreux, et particulièrement réussis : Giton et Phédon (VI, 83), Ménalque (XI, 7), l'amateur de tulipes et l'amateur de prunes (XIII, 2), Onuphre (XIII, 24)… Les portraits offrent un art plus élaboré que les maximes et réflexions, moins de tension et d'amertume.
Enfin, la réflexion s'approfondit. La Bruyère s'étonne plus encore qu'il ne s'indigne : l'homme lui apparaît comme un mystère, qu'il cherche à comprendre plus qu'à condamner. Le thème de la raison apparaît pour la première fois de façon massive, en même temps qu'un appel à l'effort : La Bruyère tente de construire une sagesse, fondée sur l'indépendance, matérielle et surtout intellectuelle.
Moins de portraits, plus de réflexions et de maximes : La Bruyère n'apporte plus grand-chose de nouveau, mais approfondit sa réflexion sur des thèmes essentiels à ses yeux ; il se retourne vers le passé (portrait du Grand Condé six ans après sa mort), retouche ses textes… Son pessimisme devient plus radical encore.
Si beaucoup d'ajouts apparaissent comme des transformations ou des redites, la plupart approfondissent le thème du mensonge et du faux-semblant (voir l'attaque contre les femmes, virulente en 1692,et que les éditions précédentes n'annonçaient pas. Mais surtout, le chapitre XVI, « des Esprits forts » est considérablement développé : La Bruyère part en campagne contre les libertins, au moment où des découvertes scientifiques pouvaient apparaître comme une menace pour la religion, au moment aussi où, le Roi ayant sombré dans la dévotion, les faux dévots se multipliaient…
Ce sera la dernière réalisée du vivant de l'auteur. Le 16 mai 1693, La Bruyère a été élu à l'Académie Française, et en juin il prononça son discours de réception qui provoqua une levée de boucliers. Le parti des Modernes publia dans le Mercure galant un article injurieux : La Bruyère se lance dans la polémique pour défendre l'ouvrage de toute sa vie… et il gagne ! Son Discours est publié, et il le joint en 1694 à sa 8ème édition avec une préface violemment hostile aux Modernes.
Il ne rajoute que 47 « remarques », dont une dizaine de portraits (cf. Théonas, VIII, 52, Irène, XI, 35 ou Arrias, V, 9). Il condamne la futilité des occupations humaines, l'éclat trompeur des biens matériels, l'aliénation causée par l'argent. Il rejette les comportements factices et l'hypocrisie, préférant même les libertins, qui osent être eux-mêmes, aux faux dévots qui contrefont la religion.
Il n'est pas facile de déterminer une structure, d'autant que La Bruyère lui-même estime que son livre a été fait plus ou moins au hasard. Peut-on dire qu'il culmine avec le chapitre XVI, apologétique, les quinze précédents constituant une revue des vanités, une charge contre les objets des passions ? Ou bien y a-t-il deux sommets, le Roi (chapitre X, Du Souverain) et la Foi (chapitre XVI, Des Esprits forts) ? Dans tous les cas, le chapitre I apparaît comme une introduction, des « propylées » pour reprendre le mot de Patrice Soler (voir bibliographie)
Toutefois, l'œuvre ne manque pas d'unité, au sein des chapitres, ou entre ceux-ci. Les chapitres sont unifiés par des motifs structurants : ainsi le VII (la Ville) marqué par le motif du carrosse, ou le VIII (la Cour), par le thème du spectacle et de la féérie.
On trouve également des personnages récurrents, entre différents chapitres :
• L'homme pressé (V, 26 ; VI, 12 ; VII, 6 et VIII, 19 (Cimon et Clitandre)
• Le Directeur de conscience (III, 36-42 ; XI, 61 ; XIV, 27-28)
• Le Nouvelliste : I, 33-34 ; V, 5 ; VII, 13 ; X, 10
• Ou encore le personnage d'Ergaste, VI, 28 et X, 8.
Tous ces personnages sont objets de critique ou de satire ; on peut leur opposer le Sage, le Philosophe, la figure de Socrate : II, 12 ; XII, 11, XII, 66.
La structure des Caractères apparaît donc,finalement, comme ouverte : elle permet une lecture libre, active, « par sauts et gambades », alors même que les lieux dans lesquels elle promène le lecteur sont figés, communs, fixés de toute éternité, ou du moins depuis Aristote et Théophraste. « Entre tous ces lieux, le lecteur circule de la manière la plus indépendante, au gré de sa seule inspiration à lui. Cette prodigieuse et insolite liberté compense ce qu'a de statique, de pétrifié, la structure du caractère. Le lecteur va et vient à sa guise au milieu d'un peuple d'essences statufiées. Le calcul rhétorique est bien d'une habileté extrême, qui laisse au lecteur la totale liberté de ses mouvements, dans le temps même où il ne saurait éviter de passer par une série de caractères parfaitement fixes et inaltérables. » (Van Delft, 1993, p. 63).
Dans quelle mesure La Bruyère met-il de lui-même dans son livre ? Le « je » est un indice dont il convient de se méfier. Nous savons peu de choses de lui (cf. biographie) : c'est un roturier, un bourgeois, qui possède une charge d'avocat mais préfère les formes brèves à l'ample plaidoirie cicéronienne, et se méfie de l'éloquence. Au contact des grands, sans doute a-t-il dû subir quelques avanies : remarque 21 « De la cour » : « C'est une grande simplicité que d'apporter à la cour la moindre roture, et de n'y être pas gentilhomme », ou encore remarque 58 : : « Ce qui soutient et me rassure contre les petits dédains que j'essuie quelquefois des Grands… »..
Il se veut avant tout moraliste, c'est-à-dire éducateur des Princes, comme La Fontaine ou Fénelon.
Sur cet auteur, voir ici. C'est le premier modèle indiscutable de La Bruyère. Il est indispensable de lire le Discours sur Théophraste, p. 59-74 de notre édition. Comme Théophraste, il pense que « toute doctrine des mœurs doit tendre à les réformer » : il faut donc appliquer les principes physiques et moraux aux mœurs du temps, tout en essayant de percevoir les constantes de la nature humaine. Il apprécie aussi « l'élégance grecque et le goût attique » de l'ouvrage. Enfin, il partage avec Théophraste une conception « fixiste » de l'être humain : le caractère est une essence, fixée une fois pour toute, et par conséquent définissable, reconnaissable, et susceptible d'entrer dans des catégories.
Il retient enfin de l'ouvrage la prudence des définitions, l'objectivité de l'observateur, l'alliance du concret et de l'abstrait, le choix de détails révélateurs ; en revanche, il en condamne la monotonie, et il approfondit considérablement l'analyse.
Ce livre qui a connu, entre 1537 et 1690 au moins vingt-deux éditions françaises, a eu une influence décisive sur notre littérature : Du Bellay, Rabelais, Louise Labé, Bonaventure Des Périers s'en sont inspirés ; Montaigne l'a lu et utilisé, et il était encore fort célèbre, quoique dans une moindre mesure au XVIIème siècle.
La Bruyère ne cite jamais Castiglione, mais cela ne signifie pas qu'il ne l'ait pas lu : d'ailleurs, il ne cite jamais d'auteur modernes et/ou étrangers. Mais il est vraisemblable qu'il ait eu au moins des notions d'italien et d'espagnol, et la dernière traduction du Cortegiano, celle de Duhamel, date de 1690 – au moment même où La Bruyère continue d'élaborer ses Caractères (voir ci-dessus, composition). On peut même dire, avec Louis Van Delft, que les Caractères de La Bruyère constituent l'ultime héritage du Cortegiano : « il est le dernier auteur, peut-être, à formuler avec tant de soin des préceptes touchant « la société et la conversation », à détailler un code de la civilité. » (Van Delft, 1971, p. 86). Chez La Bruyère comme chez Castiglione, la morale mondaine n'est que la traduction pragmatique, concrète, d'une conception philosophique de l'individu ; mais si, chez l'Italien de la Renaissance, l'idéal est atteignable, et l'homme perfectible, cette espérance, à la fin du XVIIème siècle a laissé place au pessimisme et à la désillusion : cf. V, 47 : « Je suppose qu'il n'y ait que deux hommes sur la terre qui la possèdent seuls, et qui la partagent toute entre eux deux ; je suis persuadé qu'il leur naîtra bientôt quelque sujet de rupture, quand ce ne serait que pour les limites. » (p. 244-245). De même, Castiglione confondait morale et esthétique, en voulant faire de la vie du Courtisan une œuvre d'art, aussi parfaite moralement qu'esthétiquement. A l'époque de La Bruyère, les deux notions ont divorcé, la beauté n'est plus qu'une parenthèse heureuse dans la laideur ambiante…
Le rejet de l'affectation, et l'appel à la simplicité et au naturel : dans le chapitre V (De la Société et de la Conversation) ou le chapitre III (Des Femmes), entre autres, La Bruyère condamne l'affectation, l'excès toujours ridicule, et prône la mesure. Cette constante vient tout droit du Courtisan – même si elle figurait aussi dans les morales antiques. Mais il y a aussi un « bon usage de l'apparence » : la politesse supplée ainsi aux qualités qui manquent à l'homme, et il est « honnête » de contrefaire parfois ce qui vous manque, comme la modestie (cf. V, 32 et XI, 69).
• Le monde du Cortegiano est l'abbaye de Thélème : une société choisie, hors du monde, qui recherche l'idéal de l'Homme. Dans une sorte de « jeu » se construit peu à peu l'image fantasmatique du « parfait courtisan », de la « Dame parfaite », du « parfait amour »… sans plus de lien avec la réalité.
• A l'époque de La Bruyère, on se méfie de la nature humaine, et l'on a perdu toute illusion sur la nature de l'être humain en général, et des Grands en particulier. La petite ville, aimable vue de l'extérieur, devient odieuse dès qu'on y entre (V, 49) ; les familles aux dehors aimables sont en fait traversées de violents conflits… (V, 40). Derrière les masques on ne trouve que de pitoyables pantins.
• Castiglione considérait l'Homme comme essentiellement perfectible : « Ceux qui ne sont si parfaitement doués de nature [peuvent] par soin et labeur, limer et corriger en grande partie leurs naturelles imperfections » (I, 14) : mais La Bruyère ne croit pas un instant que les conseils peuvent être suivis. La seule solution pour le Sage est de se retirer du monde : « Ne faire sa cour à personne, ni attendre de quelqu'un qu'il vous fasse la sienne, douce situation, âge d'or, état de l'homme le plus naturel ! » (XII, 109)
• Pour Castiglione, l'art est un modèle, et il faut ordonner sa vie comme un peintre ordonne ses couleurs, atteindre une apparence de naturel par la Sprezzatura, mélange de désinvolture et de négligence feinte, qui confère la grâce. L'art enseigne à voir la Beauté, et à en jouir en connaisseur. La Beauté a une valeur spirituelle, qui culmine dans le néo-platonisme.
• Chez La Bruyère, le monde a perdu son unité, comme en témoigne le caractère désordonné et fragmentaire de son œuvre. Alors que pour le Cortegiano, la Cour était le lieu idéal de l'accomplissement, elle n'est plus pour La Bruyère qu'un lieu à fuir ; la philosophie doit « armer l'homme » et le fortifier dans sa solitude et son repli. La Beauté n'est plus qu'une marchandise pour des Oronte (cf. VI, 60), qui désormais, loin d'être exclus de la cour, y font la loi…
Voir la biographie de Montaigne. Montaigne est le seul auteur que La Bruyère pastiche longuement en V,30, et il le défend vigoureusement contre Malebranche et probablement Nicole, qui le critiquaient (I, 44). Beaucoup de thèmes leur sont communs : le naturel, la dénonciation de la cruauté, de la torture, l'inégalité et la relativité des lois.
Quelques exemples : VIII 32 (l'opinion évolue selon la faveur de la Cour) rappelle un fragment du chapitre De l'art de conférer (III, 8) ; deux remarques du chapitre X, 1 et 3 (sur la soumission au gouvernement du pays où l'on est né et les dangers de la nouveauté) évoquent les Essais ; et sur le plan stylistique, goût de la maxime… Mais il ne partage pas la modestie souriante, la nonchalance et la fantaisie de Montaigne. La Bruyère est plus sérieux, plus amer, plus angoissé.
Baltasar Gracián y Morales, né à Belmonte, près de Calatayud en Espagne le 8 janvier 1601 et mort à Tarazona, près de Saragosse, le 6 décembre 1658, est un jésuite du Siècle d'or espagnol ; le Héros (1637) reflète parfaitement cette grandeur de l'Espagne ; mais en 1646, l'Oraculo Manual traduit déjà d'autres préoccupations : la question est moins de savoir « comment être un héros » que de se demander « comment vivre ».
Gracián mit un certain temps à s'imposer en France. Le Héros, traduit en 1645, eut assez peu de succès ; il fallut attendre 1671 pour que le Père Bouhours, grand lecteur de Gracián, le fasse connaître dans ses Entretiens d'Ariste et d'Eugène. Enfin, en 1684, L'Oraculo Manual est traduit par Amelot de la Houssaye sous le titre L'Homme de Cour : le succès est immense, non seulement en France, mais dans l'Europe entière. Jusqu'en 1694, date de la dernière édition anthume des Caractères de La Bruyère, L'Homme de Cour sera réédité 6 fois à Paris, 2 fois à La Haye et 2 fois à Lyon.
La Bruyère avait-il une connaissance directe du texte de Gracián ? Il ne lisait probablement pas l'espagnol, et ne cite aucun auteur qui ne soit ancien, ou français ; mais il a pu en avoir une connaissance indirecte par Corneille – qui le lisait dans le texte –, par La Rochefoucauld, la Marquise de Sablé, Bouhours ou Méré…
· Tous deux mettent l'illusion au cœur de leur conception de la vie, mais…
· Pour Gracián, l'illusion n'est pas condamnée : le monde est un théâtre, et elle fait partie de la condition humaine ; il convient donc de s'en servir. Le paraître l'emporte sur l'être qui dépend de lui, l'homme doit dissimuler ses passions. L'auteur espagnol a une conception dynamique de l'existence : c'est un voyage, et le désir est un impératif de la vie morale : la fin justifie donc le plus souvent les moyens. Sa morale est fondée sur la raison : si l'illusion est partout, alors il faut l'utiliser, déjouer ses pièges, tout en se dissimulant soi-même : « la science de plus grand usage est l'art de dissimuler. Celui qui montre son jeu risque de perdre « (98) : la question du bien et du mal semble donc quelque peu mise de coté.
· Pour La Bruyère, l'accommodement est nécessaire, et il faut parfois feindre (XI, 69), mais l'ambition du sage doit être de se dés-illusionner. La vie, surtout celle de la Cour, est un « songe » dont seuls les meilleurs s'éveillent, temporairement (VIII, 66). Sa morale vient du cœur plus que de la raison : il s'indigne que l'homme d'artifice réussisse, tandis que le mérite personnel se retrouve bafoué et blessé. Moraliste austère, peut-être influencé par le jansénisme et les Provinciales de Pascal, il exige que l'on soit « naturel » (VIII, 62)
· Pour Gracián, la vie est une guerre, ou un jeu (ce qui revient à peu près au même) : « Milicia es la vida del hombre contra la malicia del hombre » (13) :autrui ne peut être qu'un moyen, ou un adversaire. Le malheur est contagieux : il vaut mieux se tenir à l'écart des malheureux – Gracián ne brille pas par la compassion, ni par la sensibilité ! Il faut se connaître, afin de se rendre maître de soi-même et des autres. Quant à l'amitié, s'il y croit, il considère qu'il ne faut jamais se fier entièrement à un ami, et que l'amitié doit surtout être recherchée pour son utilité. Il fait sienne la devise de Publius Syrus dans la maxime 217 : « ita amicum habeas, posse amicum fieri ut inimicum putes » : aies des amis, mais de manière à penser qu'un ami puisse devenir un ennemi.
· Pour La Bruyère, la guerre et le jeu sont également barbares (V, 71) ; s'il faut se connaître, c'est pour connaître ses faiblesses. La raison ne sert pas à dominer l'autre, mais à éviter les erreurs. L'homme doit se corriger par un effort sur lui-même : cf. IV, 71, V, 75, XI, 23 et 60. Sur l'amitié, La Bruyère condamne vigoureusement la position de Publius Syrus et de Gracián (IV, 55)
· Si Gracián et La Bruyère sont tous deux davantage spectateurs qu'acteurs de la société qu'ils décrivent, leur attitude est là encore bien différente : jamais l'Espagnol ne propose le retrait, la fuite : sa morale est avant tout mondaine – au point que notre Jésuite semble plus proche des enseignements de Machiavel que de ceux de l'Évangile ! Il prône l'action, le combat.
·
Pour La Bruyère au contraire, le monde cause
l'aliénation du Moi. Par la perte de
temps : cf. VII, 20, VIII, 70, XI, 46… La Bruyère condamne le
divertissement en des termes pascaliens : cf. XII, 104. On peut considérer
que chacun des 16 chapitres des Caractères
illustre une forme d'aliénation. Par une vaine
agitation : cf. VIII, 64, V, 79… Au bout du compte on se retrouve au
point de départ. Et cette agitation est parfois criminelle : La Bruyère,
homme sensible, s'indigne de la férocité dont l'homme peut faire preuve envers
ses semblables : XI, 127.
Le moraliste peut se consoler par son « mérite personnel », même
(surtout ?) si celui-ci n'est pas reconnu. Il cède alors à la tentation du
retrait, de la fuite : VI, 27 et 29 ; V, 35 ; VIII, 98 … La
Bruyère se surnomme lui-même Héraclite ou Antisthène.
Mais la blessure reste vive ; La Bruyère ignore l'égotisme et le culte du
moi. Le moi ne se suffit pas à lui-même…
· Gracián est un Jésuite, même s'il est souvent apparu en rupture avec son ordre, et s'il est peu question de religion dans l'Oraculo Manual. Ce qui ne manque pas cependant de provoquer quelques contradictions, au point que son œuvre a été lue parfois de manière parfaitement opposée… Dans la société, la ruse est indispensable ; et cependant il la condamne : « les gens rusés se tiennent neutres, et, par une métaphysique plausible, tâchent d'accorder la Raison d'État et leur conscience. Mais l'homme de bien prend ce ménagement pour une espèce de trahison, se piquant plus d'être constant, que d'être habile » (29) ; de même, la maxime 165 semble contredire la maxime 13 (voir ci-dessus) :
« On peut bien obliger un brave homme à faire la guerre, mais non à la faire autrement qu'il ne doit. Chacun doit agir selon ce qu'il est, et non selon ce que sont les autres. La galanterie est plus plausible, quand on en use envers un ennemi. Il ne faut pas vaincre seulement par la force, mais encore par la manière. Vaincre en scélérat, ce n'est pas vaincre, mais bien se laisser vaincre ; la générosité a toujours eu le dessus. L'homme de bien ne se sert jamais d'armes défendues. C'est s'en servir, que d'employer le débris de l'amitié qui finit, à former la haine qui commence ; car il n'est pas permis de se prévaloir de la confiance pour se venger. Tout ce qui sent la trahison, infecte le bon renom. Le moindre atome de bassesse est incompatible avec la générosité dans les grands personnages. Un brave homme doit se piquer d'être tel que si la galanterie, la générosité, et la fidélité se perdaient dans le monde, elles se retrouveraient dans son cœur. »
Mais il faut s'accommoder aux conditions objectives de l'existence ; l'homme est taillé pour vivre dans cette jungle qu'est la société. Jamais Gracián ne remet en cause la vie avec les autres ; il faut donc s'efforcer de concilier la morale « mondaine » et la religion.
·
La Bruyère, lui, est un laïc, mais en même temps
un chrétien beaucoup plus orthodoxe ; imprégné de jansénisme, il est d'un
pessimisme mondain radical : quoi qu'en dise sa préface (mais c'est
peut-être un cliché), il ne croit pas vraiment que l'homme soit
perfectible : il est de plus en plus en retrait et solitaire. Cf. XII, 10,
66, 67, 70, 79. L'homme en fait est essentiellement seul ; V,59 et 70. Il
reprend presque mot pour mot le fragment 139 de Pascal dans sa remarque XI, 99.
Enfin, cf. VIII, 101.
Plus intransigeant que Gracián, il considère qu'il faut se tourner vers l'autre
monde, puisque celui-ci est avilissant : cf. XVI, 30.
Si Pascal veut rendre l'homme chrétien, La Bruyère ne vise, lui, qu'à le rendre raisonnable. Mais les points communs sont nombreux : distinction entre sots, demi-savants (ou médiocres) et grands esprits, celle entre l'esprit de finesse et de géométrie, l'éloquence fausse… Le chapitre Des esprits forts reprend Pascal.
La Bruyère s'inspire de La Rochefoucauld surtout au début des Caractères (Des femmes, Du cœur) ; il en retient la réflexion sur l'amour et l'amitié, et celles sur la fragilité et l'inconstance des sentiments. Le plus souvent, il amplifie et illustre les Maximes.
La Bruyère vit une période de profonds changements, au cours de laquelle, grâce à Tycho Brahé, Giordano Bruno, Copernic, Kepler, Galilée, Descartes, Newton, les conceptions les plus familières ont été profondément bouleversées.
Or il manifeste assez peu de curiosité scientifique ; sa conception du « moi » demeure fixiste (cf. plus haut, la morale de La Bruyère) ; de même, s'il assiste avec lucidité aux évolutions sociales et politiques de son temps, la décadence de la haute aristocratie, l'émergence d'hommes nouveaux dépourvus de naissance, c'est pour déplorer ces changements, non pas au nom d'un « ordre établi » dont il perçoit l'iniquité (voir sa condamnation de la guerre, sa peinture des paysans…), mais au nom d'un ordre idéal, et immobile… Cf. Louis Van Delft, 1993, p. 164.
En seize chapitres, pas un de plus, La Bruyère dessine un monde fixe, compartimenté, clos, comme le monde dessiné par Ptolémée.
Mais il vit aussi la « Crise de la conscience européenne » ; comme le montre Paul Bénichou dans Morales du Grand Siècle (voir Bibliographie), La Rochefoucauld a marqué la fin de l'héroïsme, qui caractérisait la première moitié du 17ème siècle, et en particulier Corneille ; désormais l'on insiste davantage sur la faiblesse de l'homme, sa condition misérable (cf. Pascal, Racine…) ; le temps humain est décevant, « la vie est un songe » : voir De l'Homme, 47, p. 410-411. On trouve ici l'idée chrétienne qui dévalorise totalement la vie ici-bas au profit d'un au-delà : le temps humain n'est plus qu'un songe confus sans la moindre action louable – le temps de Beckett !
Le « Théâtre du monde » offre certes un décor stable – mais qui n'est justement qu'un décor ; nous ne sommes que des figurants, creux et vides ; le courtisan en particulier est l'homme du vide : cf. VIII, 83 p. 338 et IX, 32, p. 356. Cela va de pair avec la vogue des « vanités » en peinture…
En tant que moraliste, La Bruyère, dans la tradition antique (de Sénèque, par exemple, dans les Lettres à Lucilius), est un « maître de vie », un pédagogue qui guide un « nouveau venu » (pour reprendre les termes de La Fontaine dans la préface de ses Fables) ; mais en réalité, il décrit plus qu'il ne prescrit.
Si l'on en croit Louis Van Delft (Anthropologie, Nature humaine et caractère à l'âge classique, voir bibliographie), deux conceptions se seraient opposées concernant l'étude de la nature humaine : l'une, héritière de Montaigne, considère l'homme dans ce qu'il a de mouvant, d'insaisissable ; elle s'exprime volontiers sous la forme de fragments ou d'essais, constamment en évolution ; les Maximes de La Rochefoucauld en seraient l'exacte illustration, donnant de l'homme une image diffractée, contradictoire ; mais Pascal se rattache également à cette école.
L'autre, au contraire, plus répandue, exprime une conception plus fixe, plus fermée de l'homme ; héritière d'une cosmographie à 4 termes (air, eau, feu, terre), et plus généralement d'un schéma quaternaire (4 saisons, 4 âges de la vie, 4 types de fièvres, 4 apôtres, 4 planètes, Mars, Jupiter, Saturne et la Lune) à quoi correspond le « microcosme » aux 4 tempéraments (mélancolique, sanguin, flegmatique, colérique), elle procède plus volontiers par classification ou taxinomie, cherchant à créer une véritable sémiotique des caractères inspirée de la physiognomonie. La Bruyère, avec ses Caractères hérités de Théophraste, mais aussi d'Aristote (voir notamment son portrait du Courageux, dans l'Éthique à Nicomaque), se place plutôt dans cette tradition, qui voit dans l'homme un livre à déchiffrer.
Mais de la taxinomie (purement descriptive) à la volonté de corriger, d'éditer une norme, il n'y a qu'un pas, que La Bruyère franchit parfois, en critiquant ceux qui, comme Télèphe, « sortent de leur caractère »… (XI, 141, p. 443.) : l'homme tient tout entier dans le « caractère » qui lui a été attribué, et chacune de ses actions et de ses réactions doit être expliquée par ce « caractère » ; vouloir en sortir, c'est mentir, ou se méconnaître. Même si parfois, le changement, l'absence de caractère fixe, constitue précisément l'essence… cf. « De l'Homme », 18.
Si La Bruyère croit en la fixité des caractères – et en témoigne l'architecture de son œuvre, 16 chapitres inchangés tout au long des différentes éditions, comme la fréquence des incipit en forme de définition : « une femme est… les Pamphile sont… », ce n'est pas pour autant qu'il ignore la nuance, ni la difficulté à juger de l'humain. Ce n'est paspour rien qu'il préfère dire « souvent, parfois » plutôt que « toujours, jamais » comme La Rochefoucauld ou Pascal…
Il est donc bien souvent difficile de juger des qualités et des défauts des hommes : les qualités peuvent être trompeuses, se révéler des défauts. On peut être courageux par vaine gloire, généreux par vanité, humble par intérêt, dévot pour suivre la mode, ou parce que l'on a passé l'âge de plaire… Le jugement dépend en grande partie du point de vue que l'on adopte : « de bien des gens il n'y a que le nom qui vale quelque chose : quand vous les voyez de fort près, c'est moins que rien ; il loin ils imposent. » (II, 2 p. 157).
Autre point qui rend difficile le jugement : tel homme est-il par lui-même vaniteux, arrogant, insupportable… ou la faute en revient-elle à ceux qui le souffrent, et qui, par leur attitude, le rendent tel ? « ce n'est pas qu'il faut quelquefois pardonner à celui qui, avec un grand cortège, un habit riche et un magnifique équipage, s'en croit plus de naissance et plus d'esprit : il lit cela dans la contenance et dans les yeux de ceux qui lui parlent. » (II, 27 p. 166) Les exemples seront nombreux, notamment dans le chapitre « Des Biens de fortune » : dans quelle mesure l'arrogance de Giton dépend-elle de la complaisance des autres à son égard ? Et l'obséquiosité de Phédon n'est-elle pas le résultat de mille humiliations reçues tout autant que d'un défaut personnel ? Rousseau n'est pas loin, qui proclamera que la société corrompt l'homme…
Enfin, le monde dans lequel vivent les personnages de La Bruyère est fondamentalement instable : un revers de fortune, une disgrâce peuvent précipiter du jour au lendemain les fortunes les mieux établies : comment la fixité du caractère pourrait-elle subsister ? Voyez Timante (De la Cour, 56), abandonné quand sa faveur décroît, puis à nouveau fêté quand sa fortune se rétablit !
Selon Hippocrate et ses successeurs, la santé se définit par l'équilibre des quatre humeurs qui circulent dans notre corps :
Chacune de ces humeurs est rattachée à l'un des quatre éléments, lui-même doté d'une qualité (froid, chaud, sec, humide). La combinaison de ces qualités produit les quatre tempéraments fondamentaux :
Or le tempérament détermine non seulement l'état de santé, mais également la psychologie – le mot n'est pas encore employé – et le comportement des individus. Il y a donc dans les caractères une large part de déterminisme physiologique. Les saisons influencent également ces humeurs : en hiver domine le flegme, au printemps le sang, en été la bile et en automne la bile noire… Les saisons tour à tour aggravent ou adoucissent les symptômes des déséquilibres : un mélancolique renaîtra au printemps, mais aura toute chance de sombrer en automne…
Cette théorie était extrêmement répandue à l'époque ; elle inspira, notamment, L'Anatomie de la Mélancolie de Robert Burton.
La Bruyère souscrit à ce déterminisme : « on n'est pas effronté par choix, mais par complexion » (VIII, 41 p. 322)
La Bruyère n'est pas un « fixiste » fanatique : il reconnaît volontiers le caractère mouvant du « moi », la part d'énigme en l'homme. Ainsi, Théodote (De la Cour, 61), est-il dévôt ou courtisan ? Il n'en sait rien lui-même ; quant à Straton (De la Cour, 96), c'est un « caractère équivoque, mêlé, enveloppé ; une énigme, une question presque indécise ». De même, dans XI, 18, La Bruyère montre un homme qui « au fond, et en lui-même ne se peut définir » ; « Des Jugements », 56 offre une série de portraits contradictoires, et s'achève par celui de Théodas, un homme double, et même triple ! « Comment le fixer, cet homme inquiet, léger, inconstant, qui change de mille et mille figures ? » (De la Mode, 19).
Il serait faux pourtant de dire, comme ce fut un temps la mode, que La Bruyère « détruit la notion même de caractère ». Si l'homme apparaît parfois comme une énigme, c'est parce qu'il est inconstant, voire inconsistant. Et il s'agit, dans ce cas, presque toujours du Courtisan, de l'homme du paraître, donc l'essence consiste précisément dans ce creux, ce vide, cette inconsistance qui le fait aller de-ci de-là au gré des modes. Mais les plus grands sentiments, et les plus sincères, ne résistent pas davantage à l'usure du temps : voir l'ensemble du chapitre « Du Cœur » (IV), et en particulier les remarques 31, 34, 35… et même 69 : la rancune elle-même est éphémère…
L'absence de caractère est déjà en soi un caractère.
Aux yeux de La Bruyère, l'essentiel de la morale consiste en une grande lucidité :
- Qui ne s'aveugle pas sur les apparences, sache distinguer la vraie grandeur de la grandeur empruntée, ne confonde pas les qualités réelles avec la fausse monnaie (de l'érudition, des bonnes manières, des sentiments…) ; qui sache reconnaître le « mérite personnel » même chez l'homme modeste, en retrait, ou dépourvu de fortune et de naissance…
- Qui ne s'aveugle surtout pas sur soi-même : ne pas prendre un effet de mode pour une réelle passion, ne pas se laisser prendre aux flatteries (ou, inversement aux mépris) d'une opinion publique sujette aux revirement. Qui ne prenne pas une faveur passagère pour une réelle valeur ; ni un attachement d'un moment pour la passion d'une vie.
- Et surtout qui, à la manière de Montaigne, conserve une certaine distance à l'égard des « vanités »… Bien qu'il aime la retraite, La Bruyère ne suggère pas, à la manière des Épicuriens, de se mettre à l'écart du monde et de la société ; il insiste mainte fois sur la nécessité de servir son pays et son roi. Mais il ne faut pas se laisser prendre aux apparences, aux vanités, et toujours se souvenir de l'essentiel : l'homme doit songer à son salut…
La Bruyère exprime la nostalgie d'un monde où les sentiments seraient vrais, où l'on pourrait faire confiance à la parole d'autrui, et se fier à l'amitié, à la reconnaissance, aux éloges et aux blâmes… où la parole ne serait pas trompeuse, viciée par le calcul politique ou l'intérêt. « Vivre avec ses ennemis comme s'ils devaient un jour être nos amis, et vivre avec nos amis comme s'ils pouvaient devenir nos ennemis, n'est ni selon la nature de la haine, ni selon les règles de l'amité : ce n'est point une maxime morale, mais politique. » (« Du Cœur », 55 p. 216)
La Bruyère nous offre une magnifique galerie de monstres, un catalogue de difformités morales ; il s'identifie volontiers à Socrate, montreur de monstres (cf. XII, 66) ; mais si le monstre fait peur, il peut également faire rire. Voir la harangue de Démocrite (XII, 119)
Mais il se montre plus souvent ironique, détaché, spectateur distant que véritablement indigné. Il prône et recherche la « retraite » : cf. la fin du chapitre « De la Cour ». Peu porté à l'indulgence, il ne tonne pas, mais se moque et rit. Il peint essentiellement des ridicules. D'où la présence constante de la satire et du burlesque.
Pour nous aujourd'hui, il semble que le XVIIème siècle soit le siècle de la morale et des moralistes : nous apercevons leur mine sévère dans le théâtre, y compris la comédie, dans les Fables, chez Pascal, chez les prédicateurs religieux, de Bossuet à Fénelon, dans les auteurs de « Caractères » et de « Maximes » – La Rochefoucauld et La Bruyère, certes, mais également une foule de « minores » qui mériteraient parfois d'être connus…
… Et pourtant, le terme de « moraliste » n'existe pas à cette époque ! L'on préfère le titre de « philosophe » ; l'on parle plus volontiers de « science de l'homme » ou de « science des mœurs »… Le mot de « moraliste » apparaît pour la première fois dans le Dictionnaire de Furetière, en 1690, soit deux ans après la première édition des Caractères ! Quant au Dictionnaire de l'Académie, dans son édition de 1694, il ignore encore le terme. En somme, la réalité a précédé sa nomination de plus d'un siècle…
· La comédie (Molière)
· La fable (La Fontaine)
· Les Maximes (La Rochefoucauld)
· La philosophie (Pascal, Descartes)
· Peintres :
1. Les « Vanités » : Holbein, Les Ambassadeurs, 1533
2. Les Âges de la vie
3. Velasquez : El Buffon
4. La Tour (et son usage de la lumière)
La Bruyère appartient, comme son ami Boileau, au courant classique ; il n'est pas anodin que les Caractères commencent par une réflexion littéraire (« Des ouvrages de l'esprit ») et s'achève par une méditation sur l'éloquence religieuse (« De la Chaire ») : l'esthétique est au cœur des préoccupations de notre auteur, comme de l'ensemble de son époque. D'ailleurs, elle n'est pas cantonnée à ces deux chapitres : on retrouve, dans les réflexions sur la mode, la conversation, par exemple, bien des remarques portant sur le « goût », donc sur l'esthétique.
- Il dénonce une pompe fallacieuse, qui donne de l'éclat à des écrits médiocres : I, 8 p. 126 ;
- Il rejette les « amas d'épithètes » (I, 13, p. 127)
- Il recherche le mot juste, qui n'est souvent que le plus simple – on ne peut que songer à M. Jourdain, qui finit par revenir à l'expression la plus naturelle dans sa déclaration d'amour : « vos beaux yeux me font mourir d'amour »… : « un bon auteur, et qui écrit avec soin, éprouve souvent que l'expression qu'il cherchait depuis longtemps sans la connaître, et qu'il a enfin trouvée, est celle qui était la plus simple, la plus naturelle, qui semblait devoir se présenter d'abord et sans effort. » I, 17 p. 129) ; on peut citer aussi le portrait-charge d'Acis le précieux (V, 7, p. 227-228).
Société et conversation sont intimement liées, par exemple dans le titre du chapitre V ; on notera également l'éloge d'Arthénice – Catherine de Rambouillet, maîtresse du célèbre salon de la Chambre bleue – en XII, 28, p. 465, ou celui de Voiture et de Sarrazin (XIII, 10, p. 510) témoignent d'une certaine nostalgie d'un temps où les femmes n'étaient point encore dévotes, et où l'esprit était roi. Par cela, il se rattache à un courant mondain, proche de Méré, La Rochefoucauld ou Saint-Évremond, pour qui le goût constituait l'essentiel, comme en témoigne la remarque finale p. 605.
Le plaisir qu'elle procure est la pierre de touche de la valeur d'une œuvre, plus même que les règles – quoi qu'il en dise dans son célèbre parallèle entre Corneille et Racine : La Bruyère, refusant le formalisme et le dogmatisme, infléchit dans le sens de la mondanité la doctrine classique. Ainsi dans I, 30 (p. 133), où il oppose un « bel » ouvrage à un ouvrage « parfait et régulier » : le Cid, pour n'être pas parfaitement conforme aux règles, n'en est pas moins « l'un des plus beaux poèmes que l'on puisse faire ». Et il reprendra cette affirmation en I, 61 (p. 152) : le génie peut s'affranchir des règles – cf. aussi II, 24 p. 165.
Si la beauté, à ses yeux, est une essence invariable (on reconnaît l'essentialisme platonicien et aristotélicien qui préside aussi à sa conception du caractère), La Bruyère déplore la variabilité et la relativité des goûts humains.
L'écrivain veut imiter « les caprices d'une conversation, avec ses sauts, ses interruptions, ses rappels au sujet », dit Antoine Garapon (1978 – voir bibliographie) : ce modèle se combine avec les choix anti-rhétoriques du moraliste chrétien (cf. ci-dessous) ; d'où le choix de formes brèves, et d'un discours discontinu, privilégiant le naturel et la spontanéité. Cela s'intègre dans une esthétique de la grâce, fortement influencée par la sprezzatura de Castiglione : cf. XII, 29 ; il dénonce :
- l'ornement qui masque la vérité (XVI, 22 p. 580)
- L'excès d'imagination (V, 17 et 65, dénonciation de la préciosité de certains salons, et de leurs sociolectes)
- Le « gothique », les ornements étrangers (I, 15)
- Le purisme (V, 15, p. 234)
En revanche, il loue la simplicité d'Arthénice (XII, 28), la modestie (II, 17 ; VI, 3, 5, 26), le goût « attique » (I, 15). La remarque I, 55 est un abrégé de sa rhétorique.
Antisthène (hétéronyme de La Bruyère) se refuse, dans la remarque XII, 21, à être nommé « auteur » ; il rejette le livre, le traité, n'inflige pas à ses lecteurs une doctrine continue, constituée.
Il affirme son goût pour « une beauté négligée, mais plus piquante » (p. 163), une « fausse simplicité » comparable à la sprezzatura chère à Castiglione. L'art doit être caché : il condamne ceux dont l'effort est trop visible (les puristes, V, 15). Le moraliste, pour être entendu, doit être « piquant », comme le prédicateur ; mais il rejette tout ce qui pouvait heurter le goût classique, c'est-à-dire la bienséance : « Marot et Rabelais sont inexcusables d'avoir semé l'ordure dans leurs écrits : tous deux avaient assez de génie et de naturel pour pouvoir s'en passer, même à l'égard de ceux qui cherchent moins à admirer qu'à rire dans un auteur. » (I, 43 p. 141).
Le bon plaisant est rare (V, 3) : La Bruyère s'insurge contre les « diseurs de bons mots » (VIII, 80 p. 337 ; XI, 96 p. 426) qui deviennent de véritables professionnels de la « petite phrase » assassine (La Bruyère se montre précurseur !...), et contre les « rieurs mécaniques » (XI, 77 p. 419-420).
A l'inverse, une saillie heureuse, une fine plaisanterie demandent de la délicatesse, une « solide subtilité » (La Rochefoucauld), du goût, c'est-à-dire de l'esprit.
Contrairement aux burlesques tels que Rabelais ou Scarron, La Bruyère use d'un burlesque léger, épuré. Certes, il fait voir, sous l'écorce de la politesse, la réalité brutale et grotesque : cf. XI, 156 p. 449. Le philosophe est trivial : comme Socrate sur l'agora, il est visible de tous, et spectateur de tout. La Bruyère se présente comme un « montreur d'ours » (VI, 12 p. 262-263 : Clitiphon est un ours !). Les grotesques pêchent le plus souvent par défaut d'humanité : outre l'ours déjà cité, pensons au « rengorgement » (néologisme !) du fat qui le transforme en volaille (V, 60 p. 247), à Mopse l'homme-chien (II, 38 p. 171), Ménippe l'homme-paon ou perroquet (II, 40 p. 172), Diphile l'homme-oiseau (XIII, 2 p. 506), les femmes-poisson (III, 5 p. 178) ou l'inclassable Iphis (XIII, 14), ni homme ni femme… L'on ne peut pas ne pas penser aux dessins de Charles Le Brun, associant hommes et animaux…
|
L'homme bœuf :
|
L'homme-oiseau :
|
L'assimilation comique, grotesque, des hommes aux animaux culmine dans la harangue de Démocrite, qui clôt le chapitre « Des Jugements », XII, 119 : « Petits hommes, hauts de trois pieds… »
La remarque XV, 5 constitue un éloge d'un prédicateur, le père Séraphin, qui prêcha le carême à Versailles en 1692 ; elle est en même temps un véritable « art poétique » de la parole religieuse – et une charge violente contre les orateurs à la mode, les « rhéteurs, déclamateurs, énumérateurs » obnubilés par les plans en trois partie (dignes précurseurs de nos sempiternelles dissertations…) : « le commun des hommes aime les phrases et les périodes, admire ce qu'il n'entend pas… » (p. 560). À cette rhétorique, La Bruyère préfère une parole simple, digne de la « sainte simplicité » de l'Église originelle : « c'est avoir de l'esprit que de plaire au peuple dans un sermon par un style fleuri, une morale enjouée, des figures réitérées, des traits brillants et de vives descriptions ; mais ce n'est point en avoir assez. Un meilleur esprit néglige ces ornements étrangers, indignes de servir à l'Évangile ; il prêche simplement, fortement, chrétiennement. » (XV, 8, p. 561).
Dans les discours des prédicateurs, il entre plus de vanité que de véritable piété… Ainsi Théodore (XV, 11 p. 562) ; et ils flattent les plus mauvais penchants de leurs auditeurs, au lieu de les instruire ou de les édifier : Théodule, XV, 14…
Une anamorphose est un objet représenté de telle sorte qu'en fonction du point de vue que l'on adopte sur lui, il prend tel ou tel aspect. Ainsi, le célèbre tableau d'Holbein, Les Ambassadeurs (1533), présente au pied des deux personnages un objet étrange, qui, vu sous un certain angle, se révèle être une tête de mort, qui transforme donc le tableau en « vanité ». Or La Bruyère affectionne particulièrement de nous montrer que les choses et les gens diffèrent suivant le point de vue que l'on adopte sur eux : « De bien des gens il n'y a que le nom qui vale quelque chose ; quand vous les voyez de fort près, c'est moins que rien ; de loin ils imposent. » (II, 2, p. 157)
Comme tous les grands moralistes, La Bruyère se fonde sur un « corpus » de caractères, sur des lieux communs immémoriaux : à cette époque, la notion de « lieu commun » n'avait rien de péjoratif, au contraire ; tout l'art de l'écrivain consiste donc à « écrire comme sien » ce qui appartient à ce fond commun. D'où une extrême attention à la forme et à sa musicalité, surtout dans des fragments qui n'ont pas l'ampleur et la magnificence des grands traités. En outre, l'art du « moraliste » n'appartient pas aux « grands genres » ultra codifiés : il conserve donc une grande liberté et une belle souplesse. Il se décline donc en fables, fragments… Ce passage à des formes brèves marque une « modernité » quelque peu paradoxale : en réalité, elle vient en effet de Sénèque ou de Tacite. Mais ce choix de la « breuitas » suppose une grande attention aux détails, et un travail rigoureux sur le style : esthétique de la « pointe » et de l'incomplétude, qui est une invitation au lecteur. Il existe donc une « poétique de la réflexion morale » (Van Delft, 2008).
A partir de 1660, le dogmatisme des « traités » est moins à la mode : on préférera une instruction fondée sur le plaisir, une lecture vagabonde, qui s'apparente à une promenade… « sans rien qui pèse, ou qui pose ».
La Bruyère se veut un adepte du « naturel », dans la langue comme en morale ; il déteste l'affectation, et se moque de la préciosité. Sa langue est donc exacte, simple, quelque peu abstraite parfois, mais toujours extrêmement maîtrisée, à la manière d'une partition musicale – et il conviendrait d'ailleurs de lire ces textes à haute voix, pour leur redonner l'éclat, la vie, le rythme et la « uis comica » que la lecture silencieuse leur enlève parfois.
Le sublime est l'objet d'interrogations et de débats en cette fin de XVIIème siècle. En 1674, Boileau a traduit et préfacé le Traité du Sublime du pseudo-Longin ; en 1693 le Discours sur l'Ode, et en 1694 les Réflexions sur Longin prolongent la réflexion ; le paradoxe du sublime, c'est l'alliance d'une extrême simplicité avec la grandeur – à l'opposé des boursouflures asianistes, et de la joliesse des concetti. Or La Bruyère ne semble pas tenir compte des travaux de Boileau : « Qu'est-ce que le sublime ? Il ne paraît pas qu'on l'ait défini. » (I, 55, p. 149). Or, à la fin du siècle, la tragédie a perdu de sa pureté depuis la retraite de Racine ; l'opéra, célébré par les Modernes et haï par les Anciens, triomphe (cf. I, 47)… Or le sublime sera au cœur des deux derniers chapitres des Caractères : dans De la Chaire, il condamne l'éloquence et l'affectation dans la parole religieuse, et souhaite un retour vers la simplicité des premiers temps de l'Église dans la prédication : en 1692, le P. Séraphin incarnera ce renouveau à Versailles (XV, 5)
Ce registre avait triomphé dans les années 1635-1655, notamment avec Scarron.
Ici La Bruyère nous fait entrer dans les coulisses ou les arrière-cuisines, montre l'homme comme une mécanique, ridicule et même parfois répugnante : cf. Crésus, Giton qui « crache fort loin et éternue fort haut », Gnathon écœurant convive, Diphile qui passe ses journées à nettoyer ses volières, et surtout Ménalque, parangon du Distrait, lointain ancêtre de Charlot ou de Monsieur Hulot.
Le portrait de Dorus (Des Biens de Fortune, 20) est à cet égard tout à fait pertinent :
|
Dorus passe en litière
par la voie Appienne, précédé de
ses affranchis et de ses esclaves, qui détournent le peuple et font faire
place ; il ne lui manque que des licteurs ; il entre à Rome avec ce cortège,
où il semble triompher de la bassesse et de la pauvreté de son père Sanga. |
La première partie du texte, jusqu'à « il semble triompher », s'apparente à une parade. Dorus, dont le nom évoque le premier Dorien, passe en litière (qui remplace le char) par la voie la plus prestigieuse de Rome ; il est précédé de tout un cortège, évoquant des licteurs : affranchis et esclaves sont des « ersatz » de licteurs – et la situation évoque immédiatement le Trimalcion de Pétrone, ancien esclave parvenu, entouré d'affranchis. Son entrée dans Rome mime donc celle des généraux triomphants, et également les entrées royales dans la France de La Bruyère.
Mais la phrase se prolonge en hyperbate : « … de la bassesse et de la pauvreté de son père Sanga ». Cette chute amène une lecture rétrospective : Sanga est le nom d'un esclave dans l'Eunuque de Térence, la plus connue des comédies de cet auteur en vogue au XVIIème siècle. Et Dorus, qui tout à l'heure évoquait un héros éponyme des Doriens… Dorus, c'est aussi un nom d'esclave, et il figure aussi dans l'Eunuque ! Dorus n'est donc pas un Empereur, tout au plus un gueux – un esclave, un eunuque – grossièrement déguisé en Empereur !
La Bruyère utilise également volontiers l'hyperbole, et la caricature, d'une manière qui rappelle Callot (1592-1635) et annonce Daumier. Lui aussi est collectionneur de « pièces rares », et aime les portraits-charges : cf. par exemple celui de Cydias, d'Iphis ou de Ménalque. Il n'hésite pas à recourir à l'esthétique de la foire, de la criée : cf. XII, 56 : « voulez-vous un autre prodige ? » p. 473, ou V, 75, où il se souvient des « cris de Paris ». Il se présente lui-même comme « Antisthène, vendeur de marée » (XII, 21 p. 460-462) : souvenir d'Érasme faisant l'Éloge de la Folie, et dont les Adages préparaient les Caractères.
Le Burlesque sert donc à dénoncer les vanités, à faire tomber les masques ; il débouche parfois sur son contraire, une parabole digne d'un moraliste augustinien.
Dans le portrait de Lise (Des Femmes, 8), nous assistons à
la toilette d'une coquette d'âge mûr qui, tout en disposant son rouge et ses
mouches sur son visage, songe à telle de ses consœurs pour qui « ce n'est
vraiment plus de son âge ». Mais l'on glisse vite du portrait plaisant de
cette sotte, qui a des yeux mais ne voit pas, des oreilles mais n'entend pas,
et une raison dont elle ne se sert pas pour se connaître, à une véritable
« vanité » sur laquelle plane l'ombre de la mort : car Lise,
toute à sa coquetterie, oublie de songer à l'essentiel, à son destin, et à
l'heure fatale qui approche…
De même, l'amateur de tulipes (De la Mode, 2), mécanisé et presque
végétalisé à l'instar de ses chères fleurs (il est « planté », il
« prend racine »…) est d'abord un ridicule, un pantin dérisoire
obsédé par une idée fixe ; mais la fin du texte se fait plus grave :
« Dieu et la nature sont
en tout cela ce qu'il n'admire point ; il ne va pas plus loin que l'oignon
de sa tulipe [..]. Cet homme raisonnable, qui a une âme, qui a un culte et une
religion, revient chez soi fatigué, affamé, mais fort content de sa
journée : il a vu des tulipes. » On notera le contraste
saisissant entre les noms ronflants des fleurs, évocatrices de magnificence
(l'Orientale, Le Drap d'Or..) et la chute : « des
tulipes » : la Remarque toute entière est donc une variation sur la
frivolité de l'éclat et de l'apparence, en somme, une Vanité.
Beaucoup de Caractères de La Bruyère sont donc « des
paraboles en style mondain » (Van Delft, 1993, p. 172)
Les mots les plus simples et les plus transparents décrivent les caractères, les sentiments et les facultés intellectuelles. Il condamne de même les « amas d'adjectifs » : ils sont rares, souvent seuls – sauf dans des cas exceptionnels où il use à dessein de l'accumulation, comme en VI, 83. De même, il use de l'adverbe avec parcimonie.
Il aime parfois utiliser des termes techniques, par goût de la précision et du détail concret : voir le vocabulaire de l'amateur de médailles, du fleuriste, de l'expert en balistique ou encore des hommes de loi (dont lui-même faisait partie).
Le mot-roi est donc le verbe, même si les plus simples dominent.
L'humour effleure partout dans les Caractères, souvent sous la forme d'un « bon mot », ou d'un jeu de mots, et La Bruyère ne dédaigne pas l'humour noir : cf. III, 81. C'est l'arme de la démystification et de la dénonciation.
Mais le plus souvent, l'art de La Bruyère réside dans la « chute », la « coda », « entraînant tout masque, tout fat, tout imposteur dans une « chute » si étourdissante qu'aucun ne s'en relève, cependant qu'un euphorique sentiment de triomphe gagne le lecteur… » (Van Delft, 2008, p. 370)
Écriture discontinue ; usage de la parataxe.
La ponctuation nous semble souvent erratique ; en réalité, elle correspond à une composition musicale plus que purement syntaxique. Les éditions modernes ont trop souvent substitué points et points-virgules à ce qui n'était chez La Bruyère qu'une virgule, « privant ainsi la phrase de son élan » (Van Delft, 2008 , p. 373) ; la phrase de La Bruyère est fluide, pleine d'élan : « l'écriture des grands moralistes marque le triomphe de l'implicite, du non-dit, de l'esthétique de l'inachèvement ; elle repose entièrement sur l'emploi du point d'orgue. » (ibid.)
Le théâtre, et plus généralement les arts du spectacle (opéra, ballet…), influencent l'ensemble de la vie quotidienne – d'où l'importance de la vue dans la vie mondaine : voir, être vu… Importance aussi considérable de la diction : nombre de Caractères semblent écrits pour être déclamés et joués…
« Dans cent ans le monde subsistera encore en son entier : ce sera le même théâtre et les mêmes décorations, ce ne seront plus les mêmes acteurs (…). » (De la Cour, 99, p. 343). Le « théâtre du monde » est donc une métaphore fondamentale, qui renvoie l'existence à une illusion, un songe (autre thème récurrent : cf. Calderón, entre autres). Cela permet de porter un regard extérieur, surplombant, sur la « comédie humaine » : une situation comparable à celle du « moraliste-expert » guide d'un novice.
La Bruyère se pose souvent en censeur de Molière, à qui il reproche de n'avoir pas toujours évité « le jargon et le barbarisme » (I, 38), et d'avoir usé d'un comique parfois grossier, proche de la farce.
Molière est souvent opposé à Térence, héritier de Ménandre, lui-même disciple de Théophraste : Térence passait à l'âge classique pour l'archétype de la comédie de mœurs. Pour La Bruyère, le comique idéal allierait « Molière et Térence ».
Dans deux de ses Caractères, La Bruyère s'amuse à « corriger » Molière :
· Le portrait de Timon(De l'Homme, 155) est un Misanthrope rectifié
· Et surtout, le célèbre portrait d'Onuphre (De la Mode, 24), critique du Tartuffe. Ici l'art du moraliste s'oppose à celui du dramaturge : tout en nuance, il privilégie le délicat, rejette la surcharge inhérente à l'art théâtral. Ces choix esthétiques apparaissent de manière récurrente dans les Caractères, et constituent une esthétique cohérente, fondée sur le naturel : hommages à Térence et à Racine qui ont peint les hommes « tels qu'ils sont »…
Pourtant le grossissement tant reproché au Tartuffe est bien présent, et plus exagéré encore, dans des Caractères comme ceux de Ménalque, Hermagoras ou Gnathon : il ne s'adresse pas seulement à ceux qui ont « de bons yeux », mais doit être compris de tous : il s'agit de « faire voir en pleine lumière » – comme Elmire pour désabuser Orgon – ce que l'on veut dénoncer.
Les Caractères se présentent souvent comme des embryons de comédies, qui ne se développent pas en intrigues suivies. La Bruyère use du style paratactique : il juxtapose des traits, sans les unifier dans une histoire. Voir le portrait de Ménalque (De l'Homme, 7) : c'est une juxtaposition de traits, autonomes et détachables, une « succession de scénarios-minute pour un théâtre burlesque » (E. Bury) : ce dispositif rhétorique permet de tester un trait de caractère dans toutes les situations possibles, et de mettre en évidence ses automatismes, son caractère mécanique.
Il met ses personnages en situation, et donne un ancrage visuel à son « Caractère » : « Tout écrivain est peintre, et tout excellent écrivain excellent peintre », affirme-t-il au début de son Discours à l'Académie française (p. 609) : il emprunte beaucoup à l'art du théâtre, en particulier l'unité d'action : ses Caractères sont généralement centrés sur un personnage pris dans une situation donnée.
« Entre caractère et portrait, quelle est la différence ? J. Plantié écrit à ce sujet : « Théoriquement, entre le caractère et le portrait mondain, les limites sont nettes, mais elles ne le sont pas toujours en réalité. On peut bien définir, comme le fait la Rhétorique à Herennius, l'effictio, c'est-à-dire le portrait, et la notatio, ou caractère ; en fait, entre l'effictio et la notatio, il n'existe pas seulement une opposition, mais des possibilités d'influence, d'échanges, voire de fusion ». » (Louis Van Delft, 1993, p. 22 n. 3)
Étymologiquement, c'est une marque : celle que l'on imprimait, dans l'Antiquité, aux esclaves fugitifs ou aux voleurs. Puis, avec Aristote et son disciple Théophraste, il devient une définition, une explication de l'homme – en somme, son essence. L'homme se définit par un « moi » fixe, invariable, définissable et donc classable (voir aussi ici). Sortir de son caractère est donc une transgression, proche de la démesure et de la folie. La pensée d'Aristote s'est donc figée à l'âge classique… Si l'on en croit le « Discours sur Théophraste », le fond de la nature humaine est immuable ; cependant, usages et coutumes, variant, eux, continuellement, contribuent à créer de nouveaux types d'hommes, à introduire variabilité et souplesse dans les catégories.
Le caractère appartient également à l'imprimerie : pour un moraliste, définir un caractère, c'est rendre un individu définissable, lisible ; on a pu dire que l'étude des Caractères constituait une véritable sémiologie, puisqu'il s'agit de repérer des signes, et de les interpréter.
Le caractère est donc parent de l'anthropologie et de l'anatomie – l'on pratique beaucoup la dissection, qui devient un véritable spectacle moral, et l'on dessine la cartographie des corps… non sans une connotation morale qui a beaucoup à voir avec les Vanités – mais aussi avec la cosmographie et la cartographie : le caractère se définit comme le « lieu » de l'être, comme le sentiment peut être décrit comme un lieu. Le lecteur de Caractères se promène donc, comme un « homo uiator », dans le chemin de la vie, d'étape en étape… Notons que les « Anatomies » fleurissent en Angleterre dès le début du siècle (Anatomy of Melancholy, de Robert Burton, 1621) et en France à partir de 1643 – l'époque même de la préciosité – jusque vers 1715… Les découvertes anatomiques de Vesale, en 1543, sont encore d'actualité ; l'amphithéâtre de Leyde est fréquenté par Descartes, auteur d'un Traité des Passions…
|
|
L'amphithéâtre anatomique de Leyden (gravure de 1612). Dans les gradins sont représentés des squelettes humains et animaux, certains portant, sur des bannières, des maximes morales ayant trait à la mort. Cette gravure montre à l'évidence le lien étroit entre la pratique de la dissection et de l'anatomie, avec la relation spirituelle et morale sur le destin humain. |
Dans les arts plastiques, portraits et autoportraits se sont multipliés à la Renaissance et à l'époque classique :
· Parce que l'on s'intéressait de plus en plus à l'homme, sa psychologie (ou son caractère), souvent dans une perspective physiognomonique : la forme du visage, comme marque sûre d'une âme. Voir par exemple les dessins de Charles Le Brun.
· Parce que l'art du miroir avait considérablement progressé (voir par exemple la Galerie des glaces, à Versailles), et que l'on se connaissait ainsi beaucoup mieux.
· Parce que l'affirmation du pouvoir absolu passait aussi par la pratique du portrait officiel : voir le portrait de Richelieu par Philippe de Champaigne, ou celui de Louis XIV.
· Parce que le roman et en particulier le roman burlesque, avait développé la vogue du portrait satirique…
Le portrait littéraire se développe dans le même temps, avec l'immense vogue des « Caractères » (et pas seulement ceux de La Bruyère ; que l'on songe notamment à la littérature anglaise…)
· Le portrait élogieux (Louis XIV)
· Le portrait satirique, si fréquent dans les Caractères : Ménalque, Arrias, Iphis, Giton et Phédon… Ce portrait est l'écho d'un véritable jeu de société, dont le Misanthrope (II, 4) s'était fait l'écho. Cet art réclame brièveté, réalisme, variété.
· L'autoportrait, comme celui de La Rochefoucauld, témoignant d'un intérêt pour l'individu, dans la tradition de Montaigne.
Le monde de La Bruyère se restreint pour l'essentiel à un double espace hiérarchisé : au sommet, la Cour ; en-deçà, la Ville. Le reste de la société est très peu présent dans les Caractères, et encore moins le reste du monde ! Cela n'est nullement spécifique à notre auteur ; on peut parler d'Européo-centrisme… pour ne pas dire de Versaillo-parisiano-centrisme !
Ceux que l'on appelle les « Grands » constituent l'essentiel des personnages présents dans les Caractères. Il s'agit des nobles de la plus haute lignée, et des princes du sang (proches parents du Roi). La Bruyère les connaissait bien, pour les avoir fréquentés dans l'entourage du grand Condé… Deux chapitres entiers leur sont consacrés : « Des Grands » et « De la Cour » ; et l'on trouve en outre des remarques les concernant dans bien d'autres chapitres – « Du Mérite personnel », « Des Biens de fortune »…
Les Grands sont d'abord riches, et considérés, voire entourés d'une véritable Cour ; ils représentent ce que la France offre de plus noble, juste au-dessous du Roi. La Bruyère se montre donc exigeant à leur égard, en dressant le portrait d'un Grand idéal ; mais la réalité des Grands est infiniment plus sombre, et les Caractères offrent un véritable réquisitoire : ils sont ingrats, ambitieux, dévorés d'orgueil, superficiels, égoïstes, intrigants, vaniteux et hypocrites, en un mot, dépourvus de qualités humaines. Pire encore : ils entraînent ceux qui les servent dans les mêmes travers, et pervertissent l'ensemble de la société.
Non seulement ils méprisent les petits – il faut entendre par là, non le peuple, qui n'existe littéralement pas aux yeux de La Bruyère, mais les nobles de moindre lignage, et de moindre fortune, et les bourgeois – et les réduisent en servitude, mais ils sont incapables de reconnaître d'autre mérite que le leur : ils se servent des hommes d'esprit, mais ne les estiment pas. Et entre eux, ils se montrent féroces…
C'est un lieu extrêmement hiérarchisé, où cohabitent les Grands, et des nobles de moindre importance, dont l'obsession est soit d'attirer l'attention d'un Grand, et de se mettre sous sa protection, soit, mieux encore, de s'attirer la faveur du Roi. C'est un microcosme grouillant, où ne règne que l'intérêt, où les situations sont extrêmement précaires – dépendant du caprice des uns et des autres – et où toute valeur morale est abolie. C'est aussi le lieu où triomphe l'apparence : chacun s'efforce de paraître riche et magnifique, quitte à se ruiner. Dans un tel contexte, il est impossible à l'homme de mérite de se faire reconnaître.
Elles ont droit à un chapitre pour elles toutes seules ; La Bruyère y critique leur légèreté, leur dépendance par rapport aux directeurs de conscience, leur souci de l'apparence, leur immoralité, leur ignorance. La Bruyère ne parle nullement de leur condition, et n'aborde qu'un point de vue moral ; ainsi, lorsqu'il dissèque les malheurs du mariage, l'infidélité des femmes, à aucun moment il ne prend en compte le fait qu'elles sont la plupart du temps mariées contre leur consentement, à des hommes qu'elles n'aiment pas (voir par exemple la remarque III, 62 : La Bruyère n'y condamne nullement de tels mariages).
Elle est présente essentiellement dans le chapitre « De la Ville » : elle occupe le dernier degré de la société qui intéresse La Bruyère, loin derrière les Grands et la Cour, qu'elle s'emploie d'ailleurs à singer. La Ville est un espace social qui s'oppose à la Cour, qui en est en quelque sorte son revers : voir la remarque IV, 29… La ville, en réalité, n'existe guère par elle-même : elle n'est que par rapport à la Cour (les Parisiens veulent singer la Cour, les Courtisans cherchent à se faire admirer de la Ville), et par rapport à la Province : elle est à la Province ce que la Cour est à elle-même, un modèle, un véritable soleil. C'est sans doute pourquoi ce chapitre est si court – 22 remarques seulement.
L'on y rencontre des magistrats (Remarque 5), des marchands anoblis de fraîche date (Remarques 9, 10, 11), quelques désœuvrés qui hantent les salons, les églises et les théâtres (12, 13), des riches bourgeois (14) ; La Bruyère épingle certaines coutumes, notamment lors des mariages (17, 18, 19)… Mais à aucun moment nous n'avons une véritable analyse sociale, même d'une seule classe. Outre l'absence remarquable de tout ce qui n'appartient pas aux salons (ni domestiques, ni artisans, ni bien sûr ouvriers chez La Bruyère…), on notera parfois le flou des distinctions : Théramène, le riche héritier est-il bourgeois ou noble ? Marchand, ou homme de loi (ce sont à peu près les deux seules catégories reconnues par La Bruyère) ? On n'en saura rien…
En somme, ce qui indispose le plus La Bruyère, c'est le fait que la Ville imite (mal) la cour : dépenses folles, mœurs dispendieuses, goût de l'ostentation, et absence de véritables relations sociales (cf. Remarque 20) : la Ville reproduit tous les vices de la Cour, sans son raffinement…
C'est le grand absent des Caractères ! Alors que La Fontaine, dans ses fables, montrait tout un petit peuple de paysans, de bergères, de jardiniers, d'artisans, La Bruyère semble presque totalement aveugle à ces réalités ; la Province est à peine mentionnée, et l'on constate qu'elle est à Paris ce que Paris est à Versailles : un pâle reflet. Dans le chapitre « De la Société et de la Conversation », La Bruyère mentionne une charmante petite ville, qu'il se garde bien de nommer (Remarques 49 et 50) : mais elle n'est agréable que de loin, en « fond de tableau » ; que l'on y entre, et l'on n'a qu'une envie, en sortir…
Certes, l'on trouve des paysans : mais tantôt ils sont représentés de manière bucolique (X, 29) – et du point de vue exclusif du propriétaire terrien, cf. remarque VII, 21 p. 305, tantôt d'une manière plus proche de la réalité, mais avec la plus grande distance possible. « L'on voit certains animaux farouches… » (XI, 128). L'on a parfois parlé de « catholicisme social » à propos de La Bruyère et du « Petit Concile », en se fondant précisément sur ce passage ; mais si la fin du texte dit qu'ils « méritent de ne pas manquer de ce pain qu'ils ont semé » (p. 439), on conviendra que c'est un peu léger pour faire de La Bruyère un précurseur des réformateurs du siècle suivant… D'autres passages témoignent de la pitié que La Bruyère ressent face à la misère : cf. XI, 82 et VI, 47 : « il y a des misères sur la terre qui saisissent le cœur ; il manque à quelques uns jusqu'aux aliments, ils redoutent l'hiver, ils appréhendent de vivre… » ; mais, bien loin d'imaginer seulement une quelconque redistribution des richesses, La Bruyère concluit : « je ne veux être, si je le puis, ni malheureux, ni heureux : je me jette et me réfugie dans la médiocrité ». Morale strictement personnelle, et « retrait » épicurien !
Enfin, on se souvient du fameux parallèle entre le « peuple » et les « Grands » (IX, 25) : « Le peuple n'a guère d'esprit, et les grands n'ont point d'âme : celui-là a un bon fond et n'a point de dehors, ceux-ci n'ont que des dehors et qu'une simple superficie. Faut-il opter ? Je ne balance pas : je veux être peuple ». Mais en vantant ici la vertu et le bonheur du peuple (précurseur en cela de Rousseau…), La Bruyère se place d'un point de vue strictement moral, oubliant au passage les misères dénoncées plus haut. Avouons aussi qu'il ne risquait guère d'être pris au mot…
La Bruyère est donc un brillant auteur de Caractères, et un moraliste ; mais n'attendons pas de lui une peinture sociale qui ne l'intéressait guère et n'entrait pas dans son dessein. N'attendons surtout pas de ce conservateur inquiet de tout changement, qu'il observe avec sympathie les mouvements qui travaillent déjà la société dans laquelle il vit…
Enfin, La Bruyère considère l'ordre établi comme une loi absolue ; le seul mouvement qui lui conviendrait serait un retour vers un ordre ancien. Ainsi, on le voit approuver la révocation de l'Édit de Nantes, (685), qui fut pourtant à la fois un crime, et une lourde faute politique et économique, qui priva la France de bon nombre d'esprits éclairés et d'hommes énergiques et novateurs, au profit de l'Angleterre et des États du Nord de l'Europe, et montra en outre que l'on ne pouvait se fier à la parole de l'État… (X, 21, 35).
La Bruyère en arrive à condamner tout mouvement, n'y voyant que cupidité et ambition : cf. VI, 23, XII, 118-119, XIV,, 1, 3, 5 et 7 : ainsi, c'est au nom de l'ordre établi qu'il condamne l'entreprise de Guillaume d'Orange, qui s'empare du trône d'Angleterre… Politiquement et socialement, La Bruyère est donc un CONSERVATEUR – même s'il contemple ce monde avec une distance ironique (cf. VIII, 74, où il initie le « procédé de l'œil neuf » pour décrire la cour).
Son univers est transparent, soumis à l'évidence de la Révélation ; La Bruyère vit une foi tranquille, inconscient du fait que des hommes tels que Bayle, Leibnitz et bien d'autres s'interrogent, exigent le libre examen de la Raison même (surtout ?) en matière de religion… A cet égard, il est même en retrait par rapport à son ami Bossuet, catholique intransigeant, mais qui accepta du moins de dialoguer avec le protestant Leibnitz.